Le mélanome est l’un des cancers de la peau les plus agressifs, mais les progrès des dernières décennies offrent aujourd’hui plusieurs stratégies curatives. Parmi elles, la radiothérapie mélanome suscite un regain d’intérêt : quand, comment et pourquoi l’utiliser ? Cet article décortique le rôle de la radiothérapie dans la prise en charge du mélanome, en s’appuyant sur les données les plus récentes et en proposant des repères concrets pour les patients et les praticiens.
Comprendre le mélanome
Mélanome est un cancer cutané qui prend naissance dans les mélanocytes, les cellules productrices de mélanine. Il représente environ 1 % des cancers cutanés, mais cause plus de 80 % des décès liés à la peau. Le stade du mélanome (I à IV) détermine le pronostic : les tumeurs superficielles (stade I‑II) sont souvent résolues par chirurgie, alors que les formes avancées (stade III‑IV) nécessitent des traitements systémiques et parfois locaux comme la radiothérapie.
Principes de la radiothérapie
Radiothérapie est l’utilisation de rayonnements ionisants pour endommager l’ADN des cellules cancéreuses et provoquer leur mort. Elle peut être délivrée de façon externe (radiothérapie externe) ou interne (brachythérapie). Le traitement est planifié avec précision grâce aux images (CT, IRM) et à des logiciels de dosimétrie, afin de maximiser la dose sur la tumeur tout en préservant les tissus sains.
Quand la radiothérapie est‑elle utilisée dans le mélanome ?
- Situation adjuvante : après une chirurgie lorsque les marges sont positives ou que le risque de récidive est élevé.
- Situation néoadjuvante : pour réduire la taille d’une tumeur inopérable avant une excision.
- Traitement palliatif : soulager les douleurs ou contrôler des métastases viscérales ou cérébrales.
- Traitement des métastases cérébrales : la radiothérapie stéréotaxique (SRS) est aujourd’hui la référence pour les lésions limitées dans le cerveau.
Ces indications dépendent de facteurs comme le site de la tumeur, le statut mutationnel (BRAF, NRAS), l’état général du patient et la disponibilité d’autres thérapies (immunothérapie, thérapie ciblée).
Types de radiothérapie employés pour le mélanome
Deux modalités se distinguent :
- Radiothérapie externe (RTx) : utilisation de faisceaux de photons ou d’électrons provenant d’un accélérateur linéaire. Elle est adaptée aux lésions cutanées, aux ganglions régionaux et aux métastases osseuses.
- Radiothérapie stéréotaxique (SRS/FSRT) : délivrance de doses très précises en un à cinq traitements, idéale pour les métastases cérébrales ou les petites lésions situées près d’organes critiques.

Comparaison des deux principales modalités
| Critère | Radiothérapie externe | Radiothérapie stéréotaxique |
|---|---|---|
| Nombre de séances | 10 - 30 fractions | 1 - 5 séances |
| Dose totale (Gy) | 45 - 70 Gy | 15 - 30 Gy (dose élevée par fraction) |
| Indications principales | Lésions cutanées, ganglions, métastases osseuses | Métastases cérébrales, petites lésions juxtacrâniennes |
| Avantages | Bonne couverture des volumes étendus, technique répandue | Précision maximale, moins de toxicité normale |
| Inconvénients | Exposure globale plus importante, risque de lésions cutanées | Nécessite un équipement spécialisé, limité aux petites lésions |
Efficacité clinique et données chiffrées
Plusieurs études récentes ont montré que la radiothérapie adjuvante réduit le taux de récidive locale de 15 % à 30 % chez les patients à haut risque. Dans le cadre du traitement des métastases cérébrales, une méta‑analyse 2023 a rapporté un taux de contrôle local à un an supérieur à 85 % avec la SRS, contre 60 % avec la radiothérapie conventionnelle.
Un essai de phase II publié en 2024 a combiné l’inhibiteur de point de contrôle nivolumab (immunothérapie) avec la radiothérapie externe pour les métastases cutanées. Le taux de réponse globale atteignait 48 % versus 30 % en monothérapie, suggérant un effet d’amplification du système immunitaire.
Gestion des effets secondaires
Les effets cutanés (érythème, desquamation) sont les plus courants après la radiothérapie externe. Pour limiter ces réactions, les équipes utilisent des crèmes à base de corticostéroïdes et des mesures de protection solaire. La radiothérapie stéréotaxique, quant à elle, peut entraîner un œdème cérébral transitoire, géré par des corticoïdes courts et une surveillance IRM à 1‑3 mois.
La combinaison radiothérapie + immunothérapie augmente le risque d’« pneumopathie immunitaire » et de colite. Un suivi étroit, incluant des analyses sanguines et une évaluation clinique hebdomadaire pendant les premières semaines, est recommandé.
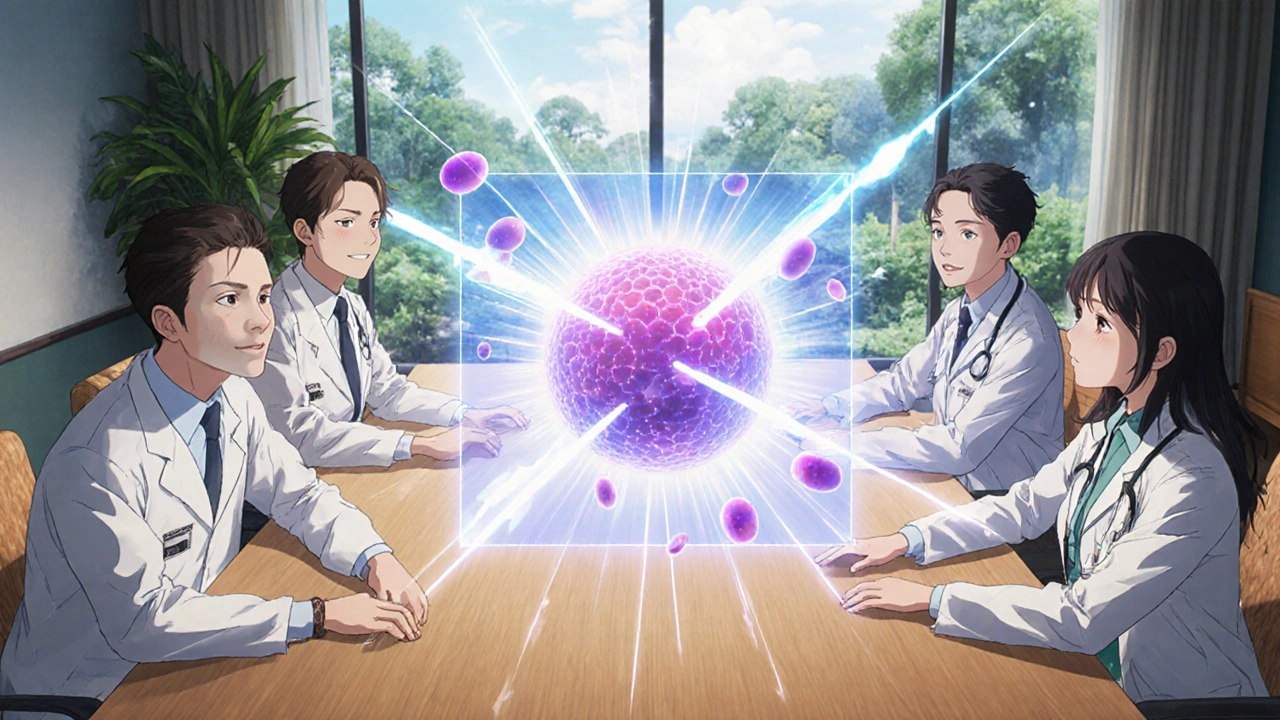
Intégration avec d’autres traitements
Le traitement du mélanome moderne repose souvent sur une approche multimodale :
- Chirurgie : excision de la tumeur primaire, souvent la première étape.
- Thérapie ciblée : inhibiteurs BRAF (ex. vemurafenib) et MEK (ex. cobimetinib) chez les tumeurs porteuses de la mutation BRAF V600E.
- Immunothérapie : anti‑PD‑1 (nivolumab, pembrolizumab) ou anti‑CTLA‑4 (ipilimumab).
- Radiothérapie : adjuvante, néoadjuvante ou palliative, selon le stade.
La séquence optimale dépend du profil moléculaire du patient. Par exemple, chez les porteurs de BRAF, on peut initier la thérapie ciblée, puis ajouter la radiothérapie pour les sites résiduels. Chez les patients bénéficiant d’une immunothérapie, la radiothérapie peut être planifiée entre les cycles pour profiter de l’effet abscopal (stimulation immunitaire à distance).
Checklist pour les patients envisagent la radiothérapie
- Confirmer le stade exact du mélanome avec un examen d’imagerie complet.
- Discuter du statut mutationnel (BRAF, NRAS) avec l’oncologue.
- Évaluer les indications : adjuvante, néoadjuvante ou palliative.
- Vérifier la disponibilité d’une technique stéréotaxique si des métastases cérébrales sont présentes.
- Planifier la coordination avec l’immunothérapie ou la thérapie ciblée (intervalle recommandé : au moins 2 semaines entre la radiothérapie et les cycles d’immunothérapie).
- Recueillir les informations sur les effets secondaires potentiels et les mesures préventives.
- Organiser un suivi post‑traitement (consultations cliniques, imagerie à 3‑6 mois).
Perspectives d’avenir
Les recherches se concentrent sur la combinaison « radio‑immunothérapie » et sur les techniques de modulation de la dose en temps réel (radiothérapie guidée par l’IRM). Les essais cliniques en cours (2025‑2027) évaluent l’efficacité de la SRS associée à l’anti‑CTLA‑4 pour les patients à haut risque de récidive cérébrale. Les premiers résultats suggèrent une amélioration du taux de survie libre de progression de 10 %.
Points clés à retenir
- La radiothérapie n’est plus réservée aux cas de rechute ; elle intervient aujourd’hui comme traitement adjuvant ou néoadjuvant selon le risque.
- La radiothérapie stéréotaxique est la référence pour les métastases cérébrales, offrant un contrôle local supérieur à 85 %.
- La combinaison avec l’immunothérapie améliore les réponses, mais nécessite une surveillance accrue des effets toxiques.
- Un suivi multidisciplinaire (oncologue, radiothérapeute, dermatologue) optimise les résultats et la qualité de vie.
Quand la radiothérapie est‑elle recommandée après une chirurgie du mélanome ?
Elle est conseillée lorsqu’une excision laisse des marges positives, que le nombre de ganglions atteints est élevé (≥ 4) ou que le facteur de prolifération (Ki‑67) dépasse 10 %. Dans ces cas, la radiothérapie adjuvante réduit le risque de récidive locale de 20 à 30 %.
Quelle différence entre radiothérapie externe et radiothérapie stéréotaxique ?
La radiothérapie externe délivre des doses fractionnées sur plusieurs semaines et traite des volumes étendus, tandis que la stéréotaxique utilise des faisceaux très ciblés en 1 à 5 séances pour des lésions petites et bien définies, notamment dans le cerveau.
Quels sont les effets secondaires cutanés les plus fréquents ?
Erythème, desquamation et parfois ulcération de la peau traitée. L’usage de crèmes à base de corticoïdes et d’aloe vera, ainsi que la protection solaire, atténue ces réactions.
La radiothérapie augmente‑elle l’efficacité de l’immunothérapie ?
Oui, plusieurs essais ont montré un effet d’abscopal : le rayonnement favorise la libération d’antigènes tumoraux, stimulant le système immunitaire et améliorant la réponse aux anti‑PD‑1.
Comment se déroule une séance de radiothérapie stéréotaxique ?
Le patient est immobilisé à l’aide d’un cadre en thermoplastique, une IRM ou un scanner de planification est réalisé, puis le faisceau est délivré en quelques minutes avec une précision millimétrique. Aucun anesthésique n’est généralement requis.
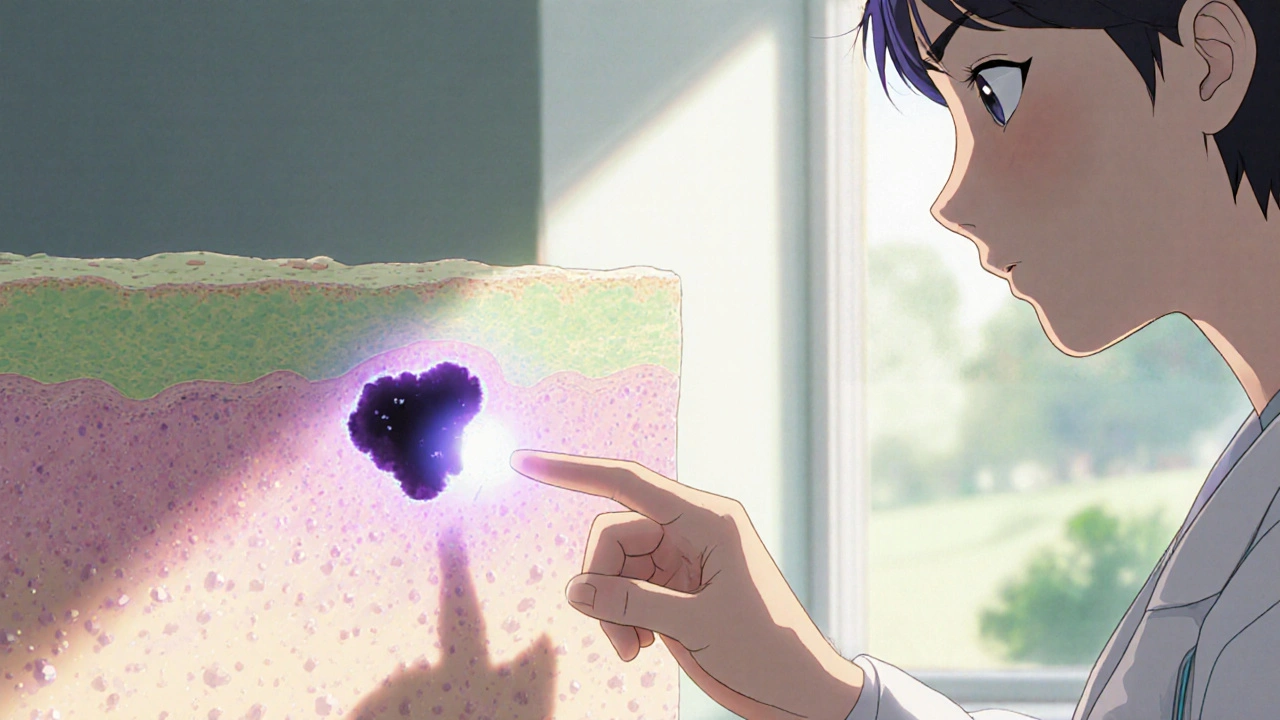



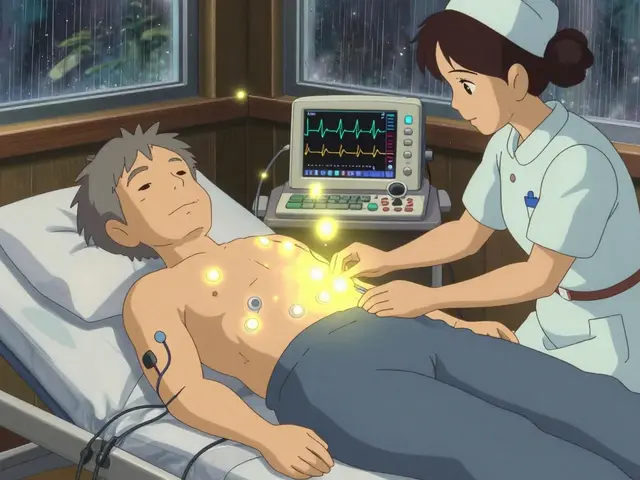

Dominique Orchard
octobre 22, 2025Après une chirurgie du mélanome avec marges positives, la radiothérapie adjuvante est indispensable. Elle réduit significativement le risque de récidive locale et améliore les chances de survie à long terme.