Les pénuries de médicaments ne sont plus des événements rares. Elles sont devenues un problème systémique qui met en danger des vies chaque jour. En 2022, l’Agence américaine des produits de santé (FDA) a enregistré 245 pénuries de médicaments, dont 62 % concernaient des injections stériles utilisées en urgence, en chirurgie ou en soins intensifs. Ces ruptures coûtent au système de santé américain plus de 216 millions de dollars par an en dépenses supplémentaires. Ce n’est pas un problème temporaire. C’est un défaut de conception dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des médicaments. Et la seule façon d’y remédier, c’est de construire une résilience durable - pas des bandages temporaires.
Le modèle actuel est cassé
Pendant des décennies, l’industrie pharmaceutique a privilégié l’efficacité coûteuse. Les entreprises ont délocalisé la production des ingrédients actifs (API) vers des pays où les coûts sont les plus bas : principalement la Chine et l’Inde. Aujourd’hui, 72 % des installations de fabrication d’API pour les médicaments vendus aux États-Unis sont situées à l’étranger. Ce modèle « juste-à-temps » fonctionnait tant que tout allait bien. Mais lorsqu’un ouragan frappe une usine en Inde, ou qu’un conflit bloque un port en Chine, le système s’effondre. Il n’y a pas de plan B. Pas de réserve. Pas de flexibilité. Juste un vide dangereux.Que signifie vraiment « résilience » ?
La résilience, ce n’est pas avoir plus de stock. Ce n’est pas simplement acheter plus de médicaments. C’est revoir entièrement la structure de la chaîne d’approvisionnement pour qu’elle puisse résister, s’adapter et se rétablir après une perturbation. Le cadre établi par les Académies nationales des sciences en 2021 définit trois piliers essentiels : anticiper, planifier, gérer les risques.Anticiper, c’est savoir où les risques se cachent. Combien d’entreprises connaissent vraiment leurs fournisseurs de niveau 3 - les producteurs de matières premières brutes ? Seulement 12 %. Le reste fonctionne dans le noir. Planifier, c’est construire des alternatives avant qu’un problème ne survienne. Gérer les risques, c’est mettre en place des mécanismes concrets pour éviter les ruptures.
Les 4 leviers concrets pour une chaîne résiliente
Il n’existe pas de solution unique. Mais quatre approches, combinées, peuvent transformer la situation.
- Stockage stratégique : Pour les médicaments critiques - comme les antibiotiques ou les anesthésiques - il faut maintenir des réserves de 6 à 12 mois. Cela coûte cher : entre 3,5 et 4,2 milliards de dollars par an aux États-Unis. Mais cela ne résout que 45 % des pénuries. Ce n’est qu’un bouclier, pas une solution.
- Diversification des fournisseurs : Ne pas dépendre d’un seul pays ou d’une seule usine. Pour chaque médicament essentiel, avoir au moins trois fournisseurs répartis géographiquement. Cela réduit les risques de rupture de 70 % avec un surcoût de seulement 15 à 20 %, selon Kearney.
- Redondance de production : Pour les 80 % des ingrédients actifs les plus utilisés, avoir deux sites de fabrication indépendants. Cela signifie investir dans des usines doubles - une en Europe, une en Amérique du Nord, une en Asie du Sud-Est. Cela augmente les coûts, mais évite les pénuries totales.
- Capacité de substitution : Dans les formulaires hospitaliers, prévoir au moins 15 % de médicaments alternatifs déjà approuvés et prêts à être utilisés. Si le médicament A manque, on passe à B sans délai. C’est une stratégie peu coûteuse, mais souvent ignorée.
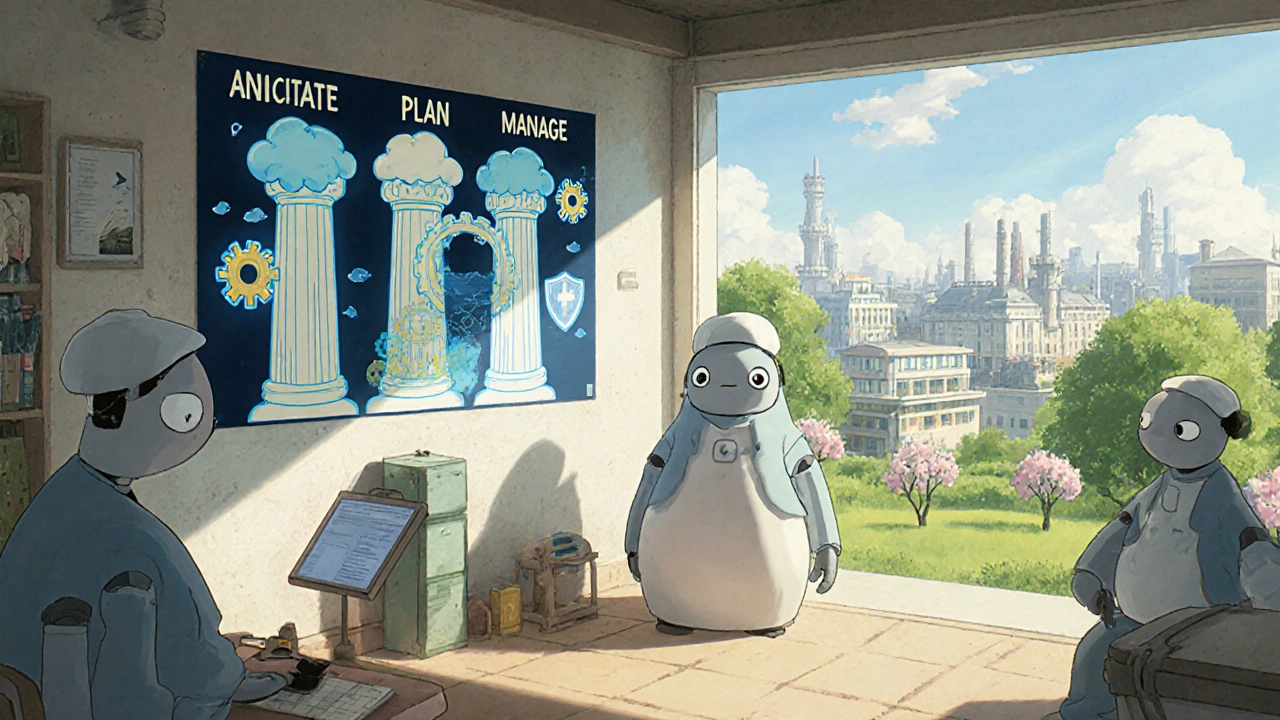
Le piège du « tout fait maison »
Beaucoup proposent de ramener toute la production aux États-Unis. C’est séduisant. Mais ça coûte 25 à 40 % de plus que la production à l’étranger. Selon L.E.K. Consulting, il serait économiquement insoutenable de relocaliser tous les médicaments. Même Pfizer, qui a investi 220 millions de dollars dans l’IA pour prévoir la demande, n’a pas essayé de tout faire à la maison. Ce qu’il faut, c’est une approche ciblée : relocaliser uniquement les médicaments les plus critiques - ceux dont la pénurie tue.
Merck, par exemple, a utilisé des subventions fédérales de 85 millions de dollars pour relocaliser la production de 12 antibiotiques essentiels. Le résultat ? 95 % de production domestique. Mais le coût a augmenté de 31 %. Pour que ce modèle fonctionne, il faut aussi revoir les prix de remboursement. Sinon, les hôpitaux ne peuvent plus acheter ces médicaments.
La technologie comme force de frappe
La meilleure affaire en matière de résilience ? La cartographie complète de la chaîne d’approvisionnement. Cela signifie connaître chaque étape : de la mine de matière première jusqu’à la pharmacie. Seulement 35 % des entreprises ont une visibilité au-delà de leur fournisseur direct. La majorité ne voit pas ce qui se passe deux ou trois étapes plus loin.
Les entreprises qui ont mis en place des systèmes de traçabilité avancés - avec l’IA pour prédire les ruptures - ont vu leurs pénuries réduites de 32 %. Et ce n’est qu’un investissement de 8 % du budget total de résilience. L’IA peut maintenant prédire avec 83 % de précision les perturbations sur un horizon de 30 jours. C’est comme avoir un radar pour les crises.
La cybersécurité, un pilier invisible
Les pénuries ne viennent pas seulement des usines fermées. Elles viennent aussi des cyberattaques. Entre 2020 et 2023, les attaques contre les chaînes d’approvisionnement de la santé ont augmenté de 214 %. Un ransomware peut bloquer une usine entière pendant des semaines. Un piratage des systèmes logistiques peut faire disparaître des livraisons.
La Healthcare Distribution Alliance recommande d’appliquer le cadre de cybersécurité NIST à tous les partenaires de la chaîne. Et surtout, de partager les informations sur les menaces entre entreprises et gouvernements. Cette collaboration a réduit le temps de réponse aux attaques de 47 %.

Les politiques qui changent la donne
Le gouvernement américain a commencé à agir. En 2024, le département de la Santé a alloué 520 millions de dollars pour soutenir la production domestique de 50 médicaments critiques. L’objectif : atteindre 40 % de production d’API sur le territoire d’ici 2027.
L’FDA a aussi publié une nouvelle directive en 2023 : chaque fabricant doit réaliser une évaluation annuelle de ses vulnérabilités. Cela devient obligatoire à partir du troisième trimestre 2025. Et plus important encore : le CMS (Centre de médicare) envisage de relier les remboursements des médicaments à la transparence de la chaîne d’approvisionnement. D’ici 2026, les entreprises devront révéler leur cartographie complète. Ce qui signifie que les investisseurs et les hôpitaux pourront choisir les médicaments venant de chaînes les plus sûres.
Le vrai coût du statu quo
Le marché pharmaceutique mondial vaut 1,4 billion de dollars. Pourtant, les investissements dans la résilience ne représentent que 1,2 % des dépenses en R&D. Pourtant, les pénuries causent 18 % des pertes de revenus de l’industrie. C’est comme si une entreprise dépensait 100 dollars pour fabriquer un produit, mais perdait 18 dollars chaque année parce qu’elle ne pouvait pas le livrer.
Le Bureau du budget du Congrès estime que si les États-Unis investissent entre 2,1 et 3,4 milliards de dollars par an dans la résilience, ils pourraient réduire les pénuries critiques de 75 % d’ici 2030. Ce n’est pas une dépense. C’est une protection.
Le chemin à suivre
Il n’y a pas de miracle. Mais il y a un plan. Il commence par reconnaître que la résilience ne peut pas être une après-thought. Elle doit être intégrée dès la conception des médicaments, des contrats, des usines et des systèmes d’information.
Les entreprises qui ont réussi - Pfizer, Merck, certains distributeurs - ont suivi une approche en trois phases : 6 mois pour cartographier, 12 mois pour prioriser les risques, 18 à 24 mois pour mettre en œuvre les solutions. Et elles ont créé des équipes dédiées : 5 à 7 spécialistes pour chaque milliard de dollars de ventes annuelles.
Les gouvernements doivent financer les infrastructures critiques, harmoniser les réglementations entre pays, et récompenser la transparence. Les hôpitaux doivent exiger des fournisseurs des données sur la sécurité de la chaîne. Les patients doivent savoir que la disponibilité d’un médicament n’est pas une question de chance. C’est une question de conception.
La prochaine crise viendra. La question n’est pas de savoir si elle arrivera. Mais si nous serons prêts.
Pourquoi les pénuries de médicaments sont-elles devenues plus fréquentes ?
Les pénuries ont augmenté parce que les chaînes d’approvisionnement ont été conçues pour minimiser les coûts, pas pour résister aux crises. La production a été concentrée dans quelques pays (Chine, Inde), les stocks sont réduits au minimum, et les entreprises n’ont pas investi dans des alternatives. Quand un événement perturbe un seul point de la chaîne - un ouragan, une grève, une attaque cyber - tout s’effondre.
Quels médicaments sont les plus à risque de pénurie ?
Les médicaments les plus à risque sont les injections stériles - comme les antibiotiques, les anesthésiques, les médicaments pour les soins intensifs - car ils sont critiques, ont une production complexe, et sont souvent fabriqués dans un seul endroit. Les médicaments génériques à faible marge bénéficiaire sont aussi très vulnérables, car les entreprises n’ont pas d’incitation à investir dans leur résilience.
La relocalisation de la production en Amérique du Nord est-elle la solution ?
C’est une partie de la solution, mais pas la seule. Relever la production aux États-Unis coûte 25 à 40 % plus cher. Ce n’est pas viable pour tous les médicaments. La meilleure approche est de relocaliser uniquement les médicaments les plus critiques - ceux dont la pénurie met des vies en danger - et de diversifier la production ailleurs pour les autres. C’est un équilibre entre sécurité et coût.
Comment les hôpitaux peuvent-ils protéger leurs patients ?
Ils peuvent agir en adoptant des formularies avec des alternatives préapprouvées, en établissant des contrats avec plusieurs distributeurs, et en exigeant des fournisseurs des données sur la traçabilité de la chaîne. Ils doivent aussi participer aux programmes de signalement des pénuries de l’FDA et éviter de stocker uniquement un seul médicament pour une même indication.
Quel rôle joue l’IA dans la résilience des chaînes d’approvisionnement ?
L’IA permet de prédire les ruptures avant qu’elles ne surviennent. En analysant des données comme les conditions météorologiques, les tensions géopolitiques, les retards de livraison et les niveaux de stock, elle peut identifier les risques avec 83 % de précision sur un horizon de 30 jours. Elle aide aussi à optimiser les stocks et à trouver des alternatives rapides. Les entreprises qui l’utilisent voient jusqu’à 38 % moins de pénuries.
Quels sont les freins à la mise en œuvre de solutions résilientes ?
Trois principaux freins : les systèmes informatiques incompatibles entre les partenaires (78 % des entreprises le signalent), le manque de personnel formé à l’analyse des risques (seulement 35 % ont des équipes compétentes), et les contrats d’achat basés uniquement sur le prix le plus bas. Les acheteurs ne sont pas récompensés pour choisir des fournisseurs plus sûrs - seulement les moins chers.
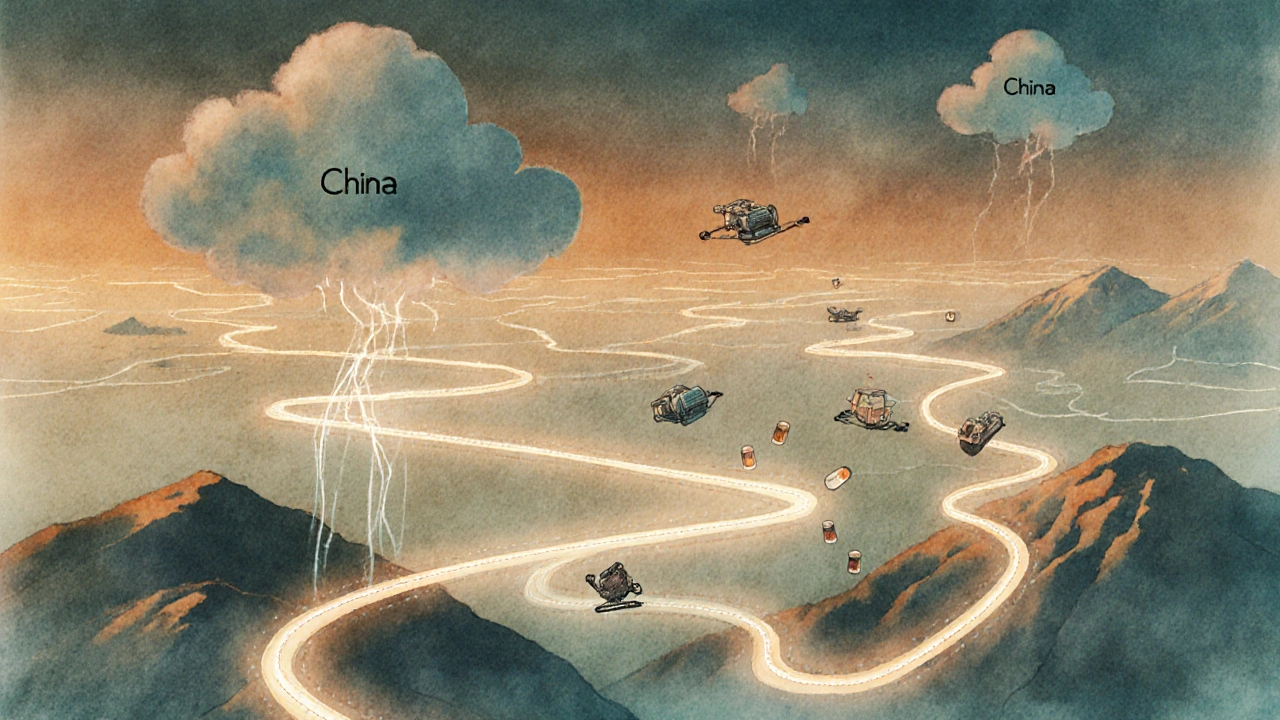




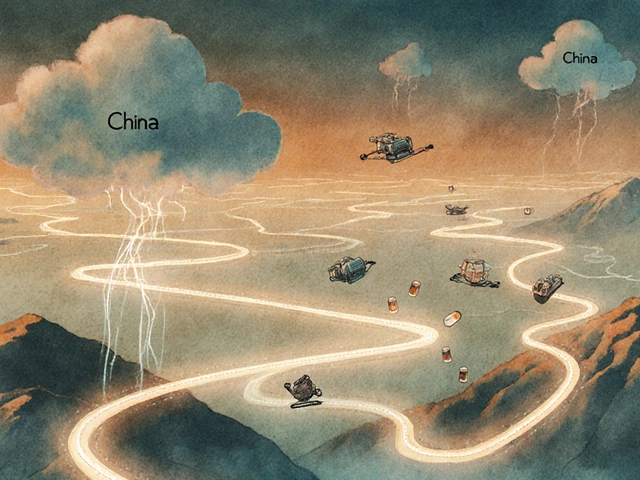
Juliette Girouard
novembre 17, 2025La résilience, ce n’est pas un mot à la mode - c’est une nécessité systémique. On a construit une chaîne d’approvisionnement comme un Jenga géant : retire un bloc, tout s’effondre. Et pourtant, on continue à privilégier la rentabilité à court terme au détriment de la sécurité sanitaire. C’est de la négligence structurelle. L’IA, la traçabilité, les stocks stratégiques - ce sont des outils, pas des solutions. La vraie révolution, c’est de repenser la valeur : un médicament n’est pas un produit comme un autre. Il est un droit fondamental. Et pourtant, on le traite comme une marchandise à marges optimisées. On parle de 1,2 % du budget R&D pour la résilience ? C’est un scandale moral. On investit des milliards dans les vaccins de luxe, mais on laisse les antibiotiques essentiels à la merci d’un ouragan en Inde. C’est du colonialisme pharmaceutique, déguisé en efficacité.